Dans son dernier essai, La Résistance écarlate, Violaine de Philippis, avocate, autrice et co-fondatrice de l’association Action Juridique Féministe analyse comment les droits des femmes reculent concrètement dans les démocraties : fermetures de planning familiaux, absence d’enquêtes, classements massifs sans suite, désinformation, instrumentalisation politique. Un livre qui documente un backlash déjà à l’œuvre.
Est-ce que c’était le bon moment pour faire un état des lieux des droits des femmes ?
Tout est parti de la campagne des législatives de 2024, après la dissolution. Au printemps, j’ai découvert qu’une femme de ma famille, allait voter pour le RN. J’ai d’abord été traversée par l’incompréhension et la colère. Et en discutant avec elle, je me suis retrouvée à répondre à toute une série d’arguments : « Le RN n’a jamais essayé », « Ce n’est pas dangereux pour les droits des femmes », « La gauche ne répond plus aux questions de la laïcité, de l’immigration, de la précarité » Cette femme travaille énormément depuis toujours. La colère sociale la touche profondément, et les droits des femmes lui apparaissent comme accessoires.
En échangeant, j’ai commencé à regrouper des faits très concrets, par exemple, leur vote contre l’indexation des salaires sur l’inflation à l’Assemblée nationale, ou leur vote contre une résolution sur l’égalité professionnelle au Parlement européen. En rassemblant ces informations pour répondre à ses objections, j’ai réalisé que, si moi je devais tout recouper pour convaincre une seule personne, d’autres militantes ou militants avaient sans doute besoin d’un outil synthétique pour faire de même. Il existe de nombreux livres, mais pas forcément un document transversal, clair, condensé, qui rassemble le backlash actuel. C’est ainsi qu’est née l’idée du livre.
Vous montrez que le backlash est systémique. MeToo a-t-il été un déclencheur ?
Oui, je le pense vraiment. MeToo a soulevé quelque chose qui touche presque à l’existentiel. Au départ, on parlait des violences sexuelles faites aux femmes, mais derrière cette question-là, il y a tout le système qui produit ces violences, il y a la question des rôles genrés. MeToo a mis en lumière que ce n’est pas parce qu’on est une femme qu’on doit se comporter d’une certaine manière, et que ce n’est pas parce qu’on est un homme qu’on doit être fort, viril, gagner de l’argent, protéger, etc. En retirant cette “feuille de route” qu’on a toujours donné aux individus, MeToo a rappelé qu’on pouvait faire autrement. Mais cette liberté-là fait peur. Quand on sort de ces rôles — faire trois enfants, avoir une carrière qui dépend de celle du mari, être douce, tenir la maison — il y a des gens qui se retrouvent face à un vertige : “Si je ne suis pas obligé·e de faire ça… qu’est-ce que je fais de ma vie ?”
Et je crois que dans cette vague réactionnaire, il y a aussi cette peur-là, la société perd ses repères traditionnels, et au lieu de se dire que c’est une chance — pour les femmes mais aussi pour les hommes — certains y voient une menace. Et ce basculement alimente aujourd’hui une grande partie du backlash.
Le mot même de backlash est attribué à Suzanne Faludi, qui est-elle ?
C’est une journaliste américaine, toujours vivante, connue pour son travail d’investigation. Dans Backlash, publié en 1991, elle analysait le mouvement réactionnaire des années 80 aux États-Unis, qui répondait à la vague féministe des années 70. Elle y détaillait comment les médias américains participaient à la diffusion d’idées antiféministes, le rôle des milliardaires et des groupes conservateurs dans ce retour en arrière et la manière dont chaque avancée des femmes déclenchait automatiquement une contre-offensive. Elle montrait aussi que cette réaction s’était prolongée dans les années 90, lorsque le féminisme s’essoufflait par rapport aux années 70, avant de revenir en force dans les années 2010, notamment avec MeToo.. Aujourd’hui, on observe un mécanisme extrêmement similaire, accéléré par les réseaux sociaux.
Justement les réseaux sociaux ont-ils rendu ce backlash encore plus violent ?
Oui, incontestablement. La désinformation circule à une vitesse inédite. Il y a trente ans, sans formation journalistique, on ne pouvait pas se poser en expert et toucher une large audience. Aujourd’hui, n’importe qui peut s’autoproclamer spécialiste sur TikTok, Instagram ou Facebook, sans déontologie, et diffuser des contenus invérifiables — notamment sur les droits des femmes et les rôles dits « naturels ». Et cette dérive dépasse les réseaux sociaux. Je pense, par exemple, à CNews diffusant en prime time que « la première cause de mortalité dans le monde, c’est l’avortement ».Le lendemain, la chaine a présenté des excuses. Mais une fois la fausse information implantée dans l’esprit de milliers de personnes, le mal est fait.
Est ce que le droit à l’avortement qui est la locomotive de ce rabotage systémique des droits des femmes ?
Tous les droits des femmes sont importants. Et sans établir de hiérarchie, on peut quand même distinguer un droit pivot, qui est le droit de disposer de son corps. Parce que si on ne peut pas choisir d’être mère ou pas, si on ne peut pas choisir d’avorter ou pas, si on ne peut pas choisir d’avoir une contraception, on se retrouve quand même “pieds et utérus liés”. Tant qu’on n’est pas en mesure de disposer de notre corps, il me semble qu’il devient difficile d’exercer les autres droits. Notamment celui de l’égalité professionnelle, puisque travailler sans maîtriser sa contraception et son désir — ou non — d’enfant, ça semble quand même plus compliqué.
Ces droits déniés dans les États totalitaires ou les théocraties reculent aussi dans des régimes démocratiques, comme aux États-Unis. Comment expliquer cette bascule dans des pays censés garantir l’égalité ?
Le danger principal, qui est déjà actuel, vient de la stagnation ou du recul de certains droits par l’inapplication des droits théoriques. C’est le grand écart entre l’égalité inscrite dans les textes et la pratique réelle de cette égalité au quotidien, notamment à des moments clés de la vie. Cela va du sexisme ordinaire aux problématiques plus graves de violences. Si, en théorie, on est décrétées égales dans les lois mais qu’en pratique il n’y a pas le budget pour faire appliquer ces droits, il n’y a même pas besoin de changer la loi pour que pèse une menace réelle sur nos droits.
La liberté d’avorter est inscrite dans la Constitution, mais, en parallèle, plusieurs centres de planning familial ont fermé, et on estime qu’une femme sur quatre doit changer de département pour avorter. De même lorsqu’une victime porte plainte, dans la quasi-totalité des cas aucune enquête n’est déclenchée rapidement. Il faut souvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans quelques situations, l’enquête démarre vite, mais c’est alors perçu comme une « chance ». Et même lorsque l’enquête finit par être ouverte, les actes d’investigation sont très souvent insuffisants, ce qui conduit à des taux de classement sans suite exorbitants : 94 % pour les violences conjugales, 86 % pour les violences sexuelles.
Est-ce un problème de moyens ou surtout de volonté politique ? L’Espagne a fait le choix d’investir massivement : qu’est-ce qui bloque en France ?
Je pense que le manque de moyens humains et matériels est réel, et qu’il est lié à un manque de volonté politique de mettre l’argent. Les deux questions sont imbriquées : c’est à la fois une question de budget et de volonté politique. Ce serait faux de dire qu’il y a assez de moyens et que ce sont les forces de l’ordre qui ne veulent pas faire leur travail. On constate qu’il n’y a pas assez d’enquêteurs et d’enquêtrices, et que les services de justice, au niveau des parquets et des juges d’instruction, ne sont pas assez fournis. Dans un contexte de restrictions budgétaires, la question des droits des femmes devient encore plus accessoire qu’avant. Quand on écoute les débats sur les lois de finances, on n’entend pas qu’il serait question de mieux budgéter les enquêtes pour qu’il y en ait vraiment quand les femmes portent plainte. Quand une femme va déposer plainte dans un commissariat, c’est un peu comme quelqu’un qui arrive aux urgences pendant le Covid, dans un CHU, lle va être reçue mais après, c’est un tunnel, elle ne sait pas où ça en est, elle ne sait pas si on va l’appeler un jour, il faut qu’elle aille elle-même à la pêche aux informations.
Vous montrez aussi que la responsabilité politique est engagée : le discours féministe est récupéré, notamment par l’extrême droite, qui occupe beaucoup plus d’espace médiatique que le reste de la classe politique. Comment l’expliquez-vous ?
Je pense que l’extrême droite, en surfant sur une colère sociale tout à fait fondée — la précarité, les injustices sociales — parvient à la rediriger contre de faux responsables : les personnes immigrées, les descendants d’immigrés, les féministes qui attaqueraient les valeurs traditionnelles, les activistes progressistes, les écologistes, etc. Et il y a cette idée que “si on remettait tout comme avant, tout s’arrangerait”, qu’on reviendrait à un monde merveilleux qui, en réalité, n’a jamais existé. La gauche, de son côté, à force de ne pas vouloir “ouvrir la fenêtre d’Overton” — c’est-à-dire élargir les sujets dont on accepte de parler —pour des raisons tout à fait légitimes, n’a pas répondu à l’extrême droite sur certains points. En refusant de démontrer que leurs arguments étaient faux, elle a laissé s’installer une désinformation croissante.
C’est un peu comme dans un tribunal, si l’on explique qu’on ne répondra pas aux arguments parce qu’ils sont racistes, erronés ou xénophobes, et que personne ne va vérifier, il n’existe pas d’argument contraire pour le juge. Et en démocratie, le “juge”, ce sont les électeurs et les électrices.
Et ce rapport à la justice, on le retrouve aussi très concrètement dans le procès intenté contre les cyberharceleurs de l’artiste Typhaine D. Les mis en cause y apparaissent comme des « monsieur tout-le-monde ». Qu’ont révélé les auditions ?
Les PV étaient édifiants. Il y en a un qui avait dit qu’il n’y avait « pas eu assez de génocidation de la femme pour qu’on parle de féminicide » — il explique que « ce n’est jamais les bonnes qui partent en premier ». On lui demande ensuite s’il a déjà été violent dans le passé, il répond « oui, j’ai mis une beigne à mon ex, mais on est toujours très copains », tout en rigolant devant les policiers. À l’audience, Il a répété qu’il n’y avait pas eu de « génocidation » des femmes, mais qu’en aucun cas il n’appelait les gens à tuer les femmes. Et ce qui est frappant, c’est qu’ils se disent tous pour l’égalité (sauf lui). mais quand on leur demande pourquoi ils ont insulté Typhaine D, la réponse,fuse : « parce qu’elle déforme la langue française, ça va trop loin ».
Votre travail vous expose à des récits très lourds et à des vagues de cyberharcèlement. Comment faites-vous pour vous protéger et continuer à travailler ?
Beaucoup de femmes viennent me voir pour des violences sexuelles au sein du couple. Ce sont des histoires très poignantes, beaucoup sont encore en dépression. Et on n’arrive pas au féminisme “par hasard”. À 22 ans, j’ai moi-même été avec un type dont j’étais folle amoureuse, le cliché du coup de foudre suivi de violences sexuelles. Et puis, en étant militante, on sait qu’on va être cyberharcelée. En 2022, j’ai vu des photos de moi en train de brûler, une carte postale disant qu’on m’inviterait pour le nouvel an avec des tirailleurs marocains, suivi d’“une orgie et notre assassinat”. Je me suis dit : « bon, j’imagine qu’il faut vivre avec ça ».
La Résistance écarlate, Violaine de Filippis-Abate, Payot, 2025
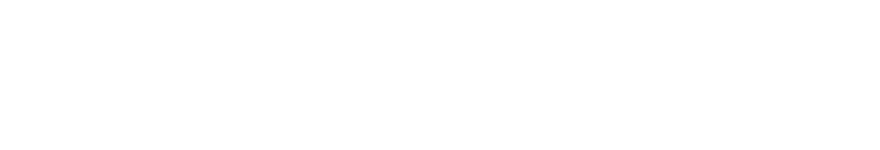




Ajouter un commentaire