Ce 26 janvier, à l’occasion de la Journée nationale contre le sexisme, le collectif Ensemble contre le sexisme dévoile sa campagne annuelle de sensibilisation, intitulée « Et si c’était l’une des nôtres ? ». Dans cet entretien, Yseline Fourtic-Dutarde, co-présidente du collectif, revient sur la banalisation du sexisme et la montée des discours réactionnaires.
Votre campagne pose une question très directe : « Et si c’était l’une des nôtres ? » Pourquoi avoir choisi cette accroche et qu’espérez-vous provoquer chez le public ?
Un électrochoc. Notre objectif avec cette campagne, c’est de mettre un coup d’arrêt à l’indifférence. Le sexisme touche évidemment nos voisines, nos filles, nos sœurs, nos mères. On voulait rappeler qu’à aucun moment il n’a disparu, et qu’au contraire il se renforce, il se réinvente. Il y a encore aujourd’hui une forme d’aveuglement très forte sur ce sujet, et nous voulions lutter contre cela. Le sexisme n’est pas un phénomène marginal, ni résiduel, il est toujours là, il est structurant, et il traverse toute la société.
Après MeToo, beaucoup pensaient que les mentalités avaient durablement changé. Pourquoi cette illusion s’est-elle dissipée, y compris chez les jeunes générations ?
On a vécu pendant un moment, notamment après MeToo, dans une forme de dilution confortable. L’idée que la libération de la parole des femmes, la dénonciation de l’ampleur des violences misogynes, allaient constituer un nouveau temps de la construction sociale. On pensait que ce nouveau temps allait mécaniquement produire plus d’égalité, plus de prise de conscience, et une volonté individuelle de s’engager contre la reproduction des stéréotypes sexistes.
Sauf que force est de constater qu’il n’en est absolument rien. On observe au contraire un fossé qui se creuse, y compris au sein des jeunes générations. Les jeunes femmes sont effectivement de plus en plus conscientes, mais un certain nombre de jeunes hommes arrivent à la conclusion que, si le sexisme est éliminé, ils perdront des privilèges sociaux, familiaux, financiers dont ils bénéficiaient jusque-là. Ils s’y refusent.
On assiste ainsi à un regain très net des discours masculinistes. Ces mouvements, qui visent à empêcher les femmes d’accéder à l’égalité, sont de plus en plus organisés, de plus en plus sectaires, de plus en plus racistes, et n’hésitent pas à recourir à la violence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la sphère physique.
Vous dites que le sexisme « frappe juste à côté ». Que dit cette formule sur notre tolérance collective au sexisme ?
Pour les hommes qui n’en sont pas victimes, la tolérance au sexisme est finalement assez élevée. Le fait de ne pas réagir face à une manifestation de violence peut relever de plusieurs choses, parfois du confort, parfois de la lâcheté, et parfois aussi d’un choix de protection.
Quand on est victime, on n’est pas forcée d’avoir en permanence l’énergie de réagir, de se défendre, de mobiliser de la colère, de l’émotion, au prix d’une fatigue mentale considérable. C’est pour cela que nous insistons sur le fait que le sexisme n’a rien d’un phénomène désincarné. Ce n’est pas «le problème des autres». Avec cette campagne, on met chaque personne au défi de trouver une femme, dans son entourage proche, qui n’a jamais été victime de sexisme. Et on sait que c’est quasiment impossible, parce que toutes les femmes ont au moins une histoire à raconter.
Le rapport du HCE sur l’état du sexisme en France publié il y a quelques jours montre que le sexisme ne disparaît pas mais qu’il se transforme et se banalise. Comment analysez-vous cette évolution ?
La dimension de la transformation est primordiale. La force du sexisme, comme celle de tout mécanisme d’oppression, c’est sa malléabilité, sa capacité à s’adapter à l’évolution de la société. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ce processus. Les phénomènes de communautarisme masculin, d’affirmation collective de la puissance masculine, se multiplient à mesure que ces outils se développent.
Il y a aussi des angoisses de plus en plus fortes liées au lendemain : le pouvoir d’achat, l’avenir de la planète, la conservation des traditions, qui ont longtemps servi de marqueurs de stabilité sociale. Tous ces déséquilibres entraînent une tentative de préservation de l’ordre établi. Ce sont des mécanismes de défense, principalement chez ceux – majoritairement des hommes – qui profitent de cet ordre, en jouissent au quotidien et qui refusent l’idée que leurs comportements puissent être remis en cause ou réinterrogés par les femmes.
Ce phénomène s’inscrit-il dans un contexte politique plus large, marqué par la montée des discours réactionnaires ?
Oui, complètement. Ce sont des mouvements réactionnaires organisés, qui disposent de moyens financiers et de leviers de puissance extrêmement importants, et qui se déploient à l’échelle mondiale pour empêcher l’avènement de l’égalité.
Et cela ne concerne pas uniquement les États-Unis ou certains pays européens. Même en France, quand le président de la République parle de « réarmement démographique », ce sont des signaux politiques très forts, qui participent de cette même logique de retour à l’ordre, de contrôle des corps et des rôles assignés.
La montée du conservatisme, du masculinisme, du complotisme, la remise en cause de la vérité scientifique : tout cela participe d’une même tendance de fond. Le sexisme est un pont idéologique central dans cette dynamique.
Travail, espace public, numérique, intimité : existe-t-il encore des angles morts du sexisme ?
Je pense que globalement, le sexisme est sous-estimé partout. Je ne dirais pas qu’il existe un secteur où il est pris à sa juste valeur, ni où l’ensemble de ses conséquences est réellement analysé.
Pour autant, on dispose d’outils pour le mesurer. Le baromètre du sexisme réalisé chaque année par le HCE permet de documenter, de quantifier et de suivre ces évolutions dans le temps. Mais la reconnaissance politique et sociale de la gravité du phénomène reste largement insuffisante.
Quelle place les hommes occupent-ils aujourd’hui dans cette lutte contre le sexisme ?
La résistance des femmes est de plus en plus forte. Est-ce que la lutte pour l’égalité est difficile ? Oui, toujours. Mais je ne suis ni fataliste ni naïvement optimiste. Notre rôle, en tant que militantes et organisations de sensibilisation et de plaidoyer, est de donner des outils pour que cette résistance puisse s’alimenter, se renforcer et prendre davantage de place dans le débat public. Certains hommes peuvent être des alliés, notamment ceux qui ont réfléchi à leur socialisation et à leurs privilèges. Mais il y en a aussi, malheureusement de plus en plus nombreux, qui se vivent comme des victimes du féminisme et qui s’engagent dans des discours masculinistes très violents.
Comment cette campagne va-t-elle se déployer concrètement ?
La campagne s’adresse à tout le monde. Nous avons cherché à la diffuser le plus largement possible, dans les transports en commun, dans des centres commerciaux, dans un certain nombre de magasins partenaires. Elle va aussi se déployer de manière très concrète dans l’espace public. Demain, un cycliste va faire le tour de Paris avec la campagne affichée, pour une balade antisexiste dans Paris. L’objectif est de développer un contre-discours féministe face à tous ces hommes qui expliquent qu’il n’est pas question de respecter le consentement, ou qui affirment que les femmes, passées 30 ans, ne seraient « plus bonnes à rien », parce qu’elles ont eu le temps de réfléchir, de s’affirmer comme des êtres humains — et que cela devient, pour eux, insupportable.
Nous avons voulu personnaliser les victimes du sexisme à travers les proches, à travers toutes les femmes que nous croisons au quotidien. Parce qu’il faut une incarnation forte pour que les choses changent.

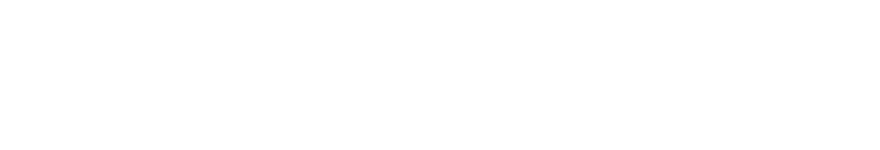




Ajouter un commentaire