Le Sénat a adopté le 20 mars une proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées pour avoir avorté ou avoir procédé à des avortements illégalement, avant la loi Veil de 1975. Échange avec Laurence Rossignol, sénatrice PS et militante féministe, à l’initiative de ce texte, qui doit encore être validé par l’Assemblée nationale.
Quelle est l’origine de la proposition de loi que vous avez portée ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de la défendre au Sénat ?
Cette proposition de loi est le prolongement d’une tribune dont j’étais signataire, publiée au moment du 50e anniversaire de la loi Veil. Ce texte rappelait que bon nombre de femmes avaient été condamnées pour avoir pratiqué ou recouru à des avortements et qu’il était temps de réhabiliter ces femmes victimes d’une législation particulièrement douloureuse. La tribune avait principalement été portée par des historiennes, comme Michelle Perrot, Christelle Taraud ou Bibia Pavard, soutenue ensuite par des écrivaines comme Annie Ernaux ou des militantes.
Que peut changer une loi « mémorielle » comme celle-ci ?
C’est une loi par laquelle le pays émet un point de vue via le parlement et reconnaît que le dispositif légal précédent avait conduit et porté atteinte à la santé des femmes ainsi qu’à l’égalité entre les femmes et les hommes. La législation avait empiété sur le droit à une vie privée et avait créé beaucoup de traumatismes à l’encontre des femmes et de leur famille. Cette loi va contribuer à dire que les femmes sanctionnées pour avoir recouru à des avortements étaient d’abord les victimes d’un ensemble législatif très défavorable aux femmes.
Nous souhaitons aussi signifier, comme les milieux féministes l’ont fait pour le viol, que la honte doit changer de camp. Car non seulement l’avortement était illégal à l’époque, mais les femmes qui y recouraient étaient en plus frappées d’infamie. C’est important de le dire, parce que l’avortement n’est toujours pas devenu un geste médical banal ; la honte qui accompagnait l’avortement avant 1975 n’a toujours pas réellement disparu.
C’est donc une loi symbolique avant tout ?
Une loi mémorielle ne transforme pas concrètement la vie des individus, mais elle a un impact à l’échelle de la société. Cette loi nous permettrait d’être au clair avec notre histoire. Elle permettrait aussi de rappeler que lorsque l’avortement est illégal, il reste pratiqué. De montrer à tous ceux qui aujourd’hui sur la planète ou même en France s’activent pour revenir sur les lois autorisant l’avortement, qu’ils militent en réalité pour le retour aux avortements clandestins
Mettre en place des indemnisations paraissait impossible, ou difficile ?
Cette proposition de loi concerne toutes les victimes de l’ensemble législatif condamnant l’avortement avant 1975. Or, elles n’étaient pas simplement les femmes condamnées, mais aussi celles qui en sont mortes, celles qui en sont souffert, celles qui ont eu des avortements clandestins dans des conditions sordides… C’est très difficile d’évaluer quelles ont été les victimes de la loi avant 1975, si ce n’est toutes les femmes ! Et aussi les enfants et l’entourage des femmes mortes des suites des complications liées à un avortement.
C’était donc compliqué de déterminer qui nous pourrions indemniser, sur quelle base. Il n’existe pas de registre des avortements avant 1975, puisqu’ils étaient clandestins. C’est aussi délicat d’établir une réparation pour des préjudices qui ont été subis en lien avec des mécanismes totalement légaux à l’époque. Mettre en place un mécanisme d’indemnisation n’a donc jamais vraiment été l’objet de cette proposition de loi.
L’unanimité qui a vu le jour à l’issue des débats (au sein de la commission des lois d’abord, puis au sein du Sénat) vous a-t-elle surprise ?
Oui, j’ai été agréablement surprise de cette unanimité. Cela montre qu’en France, il y a un consensus politique autour du droit à l’avortement. Il a déjà été posé l’année dernière avec la constitutionnalisation du recours à l’avortement, puis il a été rappelé cette année avec cette démarche. Mais les sénateurs du Rassemblement national n’étaient pas là.
Malgré l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution l’an dernier, comment la montée de l’extrême droite en France menace-t-elle la liberté des femmes à disposer de leur corps ?
Aujourd’hui, ce qui nous protège en France, c’est l’opinion publique, solidement attachée au droit à l’avortement. Et comme l’extrême droite française est volontiers opportuniste, cela limite l’expression de ses convictions sur le sujet. Mais pour défendre les droits des femmes, c’est nécessaire de toujours se battre contre l’extrême droite.
La France paraît isolée sur ce sujet. Les femmes disposent-elles d’autres soutiens internationaux solides sur le droit à l’avortement ? »
La France est isolée, ou au choix exemplaire et encourageante. Entre la constitutionnalisation l’année dernière et cette proposition de loi cette année, nous envoyons un message aux autres pays pour réaffirmer qu’il y a des États qui ne cèdent pas à l’offensive contre les droits des femmes et en particulier leurs droits à la santé sexuelle et reproductive
La constitutionnalité de l’IVG a constitué une avancée l’an dernier, mais elle ne garantit pas l’exercice de ce droit pour toutes les femmes sur notre territoire. Quels sont les freins identifiés à lever ?
L’accès de toutes les femmes à l’avortement nécessite une politique publique volontariste et en particulier une carte de l’accès au soin, pour faire en sorte qu’aucune femme en France ne se retrouve privée du droit à l’avortement en raison d’une trop grande distance avec une personne qui le pratique. Il faut aussi que nous veillons à ce que les centres hospitaliers accueillent des médecins pratiquant les avortements et qui n’exercent pas leur clause de conscience. Il n’y a pas de débat législatif sur le sujet de cette clause de conscience, mais j’espère aussi que cela reviendra.
Votre texte propose aussi de créer une commission nationale indépendante, chargée de recueillir et de transmettre la mémoire des femmes ayant avorté clandestinement. Pourquoi ?
La proposition de loi souhaite créer une commission d’historiennes chargées de recueillir la parole de femmes d’avant 1975 et aussi des descendantes de ces femmes. Le but, c’est que l’histoire de l’avortement, l’histoire des femmes qui ont avorté, l’histoire des femmes avorteuses… qui sont très peu documentées, le soient enfin. Il y a des histoires familiales à raconter, des histoires de femmes qui ont été passées sous silence
Dans le droit mémoriel, ce genre de commission existe. Cela permet de ne pas laisser les historiennes se débrouiller toutes seules. C’est un outil supplémentaire pour recueillir cette parole, qui institutionnalise cette démarche.
Quel est le reste du parcours législatif prévu pour cette proposition de loi ? Quand pourrait-on espérer la voir appliquer ?
Elle doit être étudiée par l’Assemblée nationale, mais il n’y pas de date encore à l’ordre du jour. J’ai demandé au gouvernement de la reprendre pour la proposer sur le temps gouvernemental, mais pour l’instant je n’ai pas de réponse. J’ai bon espoir qu’elle puisse être adoptée conforme au Sénat et donc ne nécessiter qu’une seule lecture.
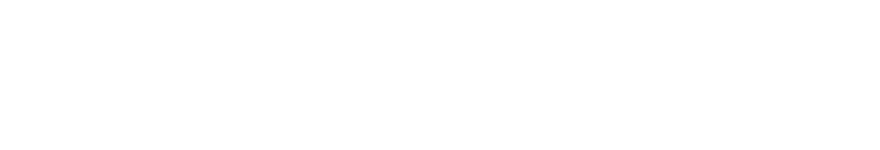






Ajouter un commentaire