Tous les jeudis depuis 1977, les « Mères de la place de Mai » se réunissent au centre de Buenos Aires pour connaître le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature. Un combat doublé de revendications démocratiques et sociales, en particulier depuis l’élection du président Javier Milei.
« Madres de la Plaza, el pueblo las abraza » (« Les mères de la Place, le peuple les embrasse »), clame la foule qui entoure les Mères de la Place de Mai. Sans discontinuer depuis 1977, celle-ci battent toujours le pavé, avec un foulard blanc sur la tête, symbole des langes de leurs enfants disparus lors de la dernière dictature militaire, au pouvoir de 1976 à 1983. Chaque jeudi, elles se donnent rendez-vous sur l’esplanade de la Place de Mai qui leur a donné leur nom, faisant face à la Casa Rosada, siège du gouvernement.
Début janvier, sous un soleil intense, elles étaient encore au rendez-vous, soutenues par une assistance de tous les âges. Aujourd’hui, la plupart des Mères de la place de Mai ont dépassé les 80 ou les 90 ans. Elles font le tour de la place poussées dans des chaises roulantes, avec une photo de leur fils ou de leur fille disparue sur leurs genoux. Elles chantent. Elles acclament. La lutte est devenue intergénérationnelle et la relève est là. Autour d’elles, il y a par exemple Malena, 17 ans, qui les a rejoint il y a quelques mois, touchée pour sa part par la disparition de deux de ses grands-parents pendant la dictature.
Une mobilisation hebdomadaire qui remonte à 1977
L’histoire des Mères de la place de Mai remonte à 1977. Une dizaine de femmes se sont retrouvées sur cette place centrale de Buenos Aires, réunies par leur chagrin et bientôt rejointes par d’autres. Leur fils ou leur fille avait « disparu » : arrêté·es, torturé·es ou tué·es par la dictature militaire ou sa milice. Elles réclamaient au pouvoir en place de connaître leur sort. Les militaires leur ont ordonné de circuler, n’approuvant aucune manifestation statique. Elles se sont alors mises à marcher autour de l’obélisque au centre de la place pour défier le pouvoir en mouvement.
Traitées de « Folles de la place de Mai » par la dictature pour discréditer leur mouvement, elles ont tenu bon, se sont réappropriées l’expression, ont fini par obtenir la condamnation de certains tortionnaires. Certaines d’entre elles ont retrouvé leur fils, leur fille, ou des petits-enfants, arrachés à leurs parents et souvent adoptés par des familles proches du pouvoir. Mais la plupart restent sans nouvelle et en réclament toujours. Malgré la fin de la dictature militaire, la marche circulaire n’a donc jamais cessé. « Jamais nous n’arrêterons d’exiger à chaque gouvernement de rechercher nos proches disparus et à la justice de connaître la vérité sur le sort de nos filles et de nos fils », déclament-elles. Les noms de ces proches sont égrenés au cours de la mobilisation, pour continuer de les faire exister.
Donner l’exemple quand la démocratie est en jeu
Aujourd’hui, 130 enfants disparus – désormais adultes – ont été identifiés grâce aux actions des Mères de la place de Mai. Mais les associations d’historiens et des droits de l’homme évaluent plutôt à 30 000 le nombre total de disparus. Un chiffre que réfute Javier Milei. Durant toute sa campagne, l’actuel président a minimisé les crimes de la dictature, les qualifiant de simples « excès ». De quoi mettre en rogne ces mères qui continuent de souffrir de la disparition de leurs proches et du manque d’informations sur leur destin, tenues confidentielles par l’armée.
« Quand la démocratie est en jeu, ce sont toujours les Mères qui donnent l’exemple », ont lancé les organisations syndicales en Argentine à l’issue de l’élection de Javier Milei et du premier jeudi de mobilisation post-électoral des Mères de la place de Mai. L’esplanade était alors noire de monde. Depuis, les jeudis, le décret fourre-tout du président Milei est dénoncé sur place et le Parlement est appelé à prendre ses responsabilités.
Cette émotion était encore palpable début janvier dans le discours de Carmen Arias : « Je pense que nous, les vieilles femmes, avons réalisé quelque chose que personne n’avait encore jamais fait en endurant la lutte et en prenant vie grâce à la Place. La Place [de Mai] donne au monde un sens différent, elle apprend aux gens à se battre et à se rebeller. » Des valeurs dont plusieurs dizaines de milliers d’Argentin·es se sont emparé·es mercredi 24 janvier, manifestant dans plusieurs villes du pays ou prenant part à une grève générale, pour dénoncer les réformes ultralibérales de Milei, actuellement étudiées au Parlement.
Lire aussi : ARGENTINE : LES DROITS DES FEMMES MENACÉS PAR JAVIER MILEI LE NOUVEAU PRÉSIDENT
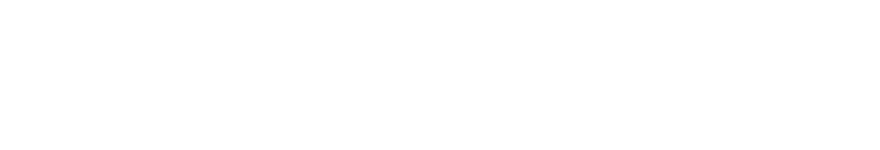






Ajouter un commentaire